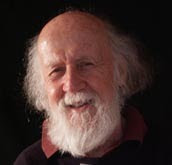L'Ile du Havre telle que vue de l'Hôpital de Havre-Saint-Pierre
21 janvier 2011
La nature est toujours apaisante. Un hôpital en soit, ce n'est pas ce qu'il y a de plus gai. Mais, dans un site aussi enchanteur, il me semble qu'on ne peut voir la réalité de la même façon. Le décor a un visage humain, si je peux m'exprimer ainsi. Quand je regarde la mer, il me semble qu'elle me parle. Et le plus fascinant, c'est qu'elle n'est jamais pareille d'un jour à l'autre. Ça n'a rien à voir cependant avec le changement sur la côte qui la longe.
Retour de la chasse aux phoques, Havre-Saint-Pierre


Dernièrement, il s'est produit un événement plutôt sympathique me permettant de faire des ponts entre ce que je vois tous les jours et ce qu'il y avait avant dans le même décor. Une cayenne s'est retrouvée sur mon blogue par hasard. J'ai reçu un courriel m'invitant à la rencontrer. Ceci m'a permis de prendre connaissance de photos et de livres passionnants sur l'histoire de Havre-Saint-Pierre. Une véritable mine de renseignements me permettant mieux saisir le passé d'ici et ses mystères. J'ai été renversé par tout ce que j'ai pu voir, apprendre ou comprendre. J'ai retiré certains billets afin de les réviser et mieux illustrer les sujets dont j'avais parlé.
 Un autre hasard vient colorer le tout: mon fils de 40 ans m'a raconté ce matin qu'il regardait tous les jours depuis quelques temps une réprise d'une série télévisée qui date de nombreuses années: Terre humaine Le titre dit bien ce qu'il a à dire. On y voit une société riche, à taille humaine qui vit simplement en harmonie avec la nature. Et il y a de ce monde quelque chose qu'on retrouve encore ici. On dirait cependant qu'on voudrait changer cet univers et le plus vite possible, le moderniser, le rentabiliser, le peupler au maximum, hanacher ses rivières. Pour le projet de barrages électriques, 13 des 16 plus grandes rivières du Québec seront détournées. La cayenne que j'ai rencontrée me disait une phrase qui m'a fait réfléchir: Ne montre pas trop comment on est bien ici, il y a trop de mondes qui vont vouloir venir. Son regard en disant long sur ce qu'elle ressentait et avec raison.
Un autre hasard vient colorer le tout: mon fils de 40 ans m'a raconté ce matin qu'il regardait tous les jours depuis quelques temps une réprise d'une série télévisée qui date de nombreuses années: Terre humaine Le titre dit bien ce qu'il a à dire. On y voit une société riche, à taille humaine qui vit simplement en harmonie avec la nature. Et il y a de ce monde quelque chose qu'on retrouve encore ici. On dirait cependant qu'on voudrait changer cet univers et le plus vite possible, le moderniser, le rentabiliser, le peupler au maximum, hanacher ses rivières. Pour le projet de barrages électriques, 13 des 16 plus grandes rivières du Québec seront détournées. La cayenne que j'ai rencontrée me disait une phrase qui m'a fait réfléchir: Ne montre pas trop comment on est bien ici, il y a trop de mondes qui vont vouloir venir. Son regard en disant long sur ce qu'elle ressentait et avec raison.
Une des aspects qui intéressent le plus mon fil de 40 ans dans cette série, Terre Humaine, c'est la beauté des valeurs qu'on y présente. Il est vrai qu'à cette époque on portait beaucoup d'attention aux valeurs qu'on véhiculait dans les séries télévisées. Aujourd'hui il y en a pour tous les goûts, si on peut dire.
Elle a beaucoup changé notre société ces dernières années. On juge sévèrement l'héritage culturel et religieux qui nous a été laissé.
Il y a environ 5 ans, j'ai rencontré une religieuse toute costumée dans un supermarché. Je lui ai tendu la main et je lui ai dit: Ma Soeur, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour le Québec, avec compétence et générosité. Vous avez jeté les bases d'une société qui ne serait jamais comme elle est aujourd'hui si vous n'aviez pas été là.
Il fallait voir l'air de cette religieuse après avoir entendu mon commentaire. Elle est restée bouche bée un instant. Puis elle a dit: Monsieur, c'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça! Elle avait l'air très émue.
Mon geste, c'est ce qui s'appelle de la reconnaissance. C'est le thème du dernier billet de Zoreilles: Gratitude . Et de la gratitude j'en ai. J'ai bien connu des religieuses dignes d'admiration, aimables, dévouées. À l'époque où je les ai côtoyées, il y avait encore de jeunes postulantes dont c'était une véritable vocation, un don de soi. Et je leur suis reconnaissant pour tout ce qu'elles ont été.
 Quand je parle de religieuses, je ne parle pas de religion, mais de la réalité de tout ceux et celles qui ont voulu un monde idéal ici, leur souci d'instruire et soulager la misère. On a critiqué leur rôle dans bien des domaines, comme l'univers des asiles d'aliénés. Mais elles ont fait ce qu'elles ont pu, avec les connaissances et les moyens qu'elles avaient. Quel courage, elles devaient avoir pour chercher à s'épanouir dans de telles conditions. La solution d'aujourd'hui n'est guère plus reluisante. On a vidé les asiles d'aliénés pour envoyer tous ces gens à la rue.
Quand je parle de religieuses, je ne parle pas de religion, mais de la réalité de tout ceux et celles qui ont voulu un monde idéal ici, leur souci d'instruire et soulager la misère. On a critiqué leur rôle dans bien des domaines, comme l'univers des asiles d'aliénés. Mais elles ont fait ce qu'elles ont pu, avec les connaissances et les moyens qu'elles avaient. Quel courage, elles devaient avoir pour chercher à s'épanouir dans de telles conditions. La solution d'aujourd'hui n'est guère plus reluisante. On a vidé les asiles d'aliénés pour envoyer tous ces gens à la rue.
On pourrait parler aussi de beaucoup de services qui ne sont pas couverts parce que l'on n'a pas su trouver d'alternative. On pourrait parler d'enfants en danger qu'on ne peut protéger, faute de moyens, de ressources même financières.
Il ne faut pas oublier qu'au début de la révolution tranquille, dans les années 60, le Québec n'avait aucune dette. Aucune. Ce n'est pas un hasard.
Ceci étant dit, je crois qu'au point où nous en sommes, la société doit demeurer laïque. Quand je vois tous les crimes commis au nom de Dieu, je renonce à voir la religion contrôler nos vies. Mais ceci ne doit pas nous empêcher de reconnaître l'héritage des générations passées.
La reconnaissance, ça fait partie d'une des valeurs qui ont perdu de leur lustre au fil des ans. On l'a remplacée par un jugement sévère envers des institutions, des hommes et des femme qui ont fait de leur mieux. Dommage!
Le rôle des communautés religieuses dans le domaine de l'enseignement et de la santé est incroyable. Elles étaient à l'image de toutes les femmes du Québec qui ont eu un rôle déterminant sur la société qui est la nôtre. On ne peut jamais imaginer assez tout ce que ces femmes ont pu réaliser dans des conditions tellement pénibles. La plupart l'ont fait avec imagination, générosité et renoncement. Elles ont donné leur vie. Ce n'est pas rien. Il faut penser que Havre-Saint-Pierre, une municipalité qui a plus de 150 ans, n'était pas relié au reste du Québec jusqu'à tout récemment. La main d'oeuvre qualifiée n'était pas facilement disponible ou accessible.
 Fondée en 1857, la paroisse de Havre-Saint-Pierre n'a pas eu de maison d'enseignement durant les 5 premières années. Les mères de famille qui n'avaient reçu qu'un enseignement primaire aux Iles de la Madeleine devaient s'occuper elles-mêmes d'apprendre à leurs enfants à lire, écrire et compter. En 1882, ce fut toute une révolution. On réussit à attirer un premier instituteur: Louis Ouellet. Il enseignait les matières de base dans la sacristie de l'église.
Fondée en 1857, la paroisse de Havre-Saint-Pierre n'a pas eu de maison d'enseignement durant les 5 premières années. Les mères de famille qui n'avaient reçu qu'un enseignement primaire aux Iles de la Madeleine devaient s'occuper elles-mêmes d'apprendre à leurs enfants à lire, écrire et compter. En 1882, ce fut toute une révolution. On réussit à attirer un premier instituteur: Louis Ouellet. Il enseignait les matières de base dans la sacristie de l'église.
L'évêque de l'époque, Mgr Bossé, avait sollicité plusieurs communautés religieuses pour trouvé de la main d'oeuvre enseignante. Il avait acquis 3 terrains, en bordure de la mer, près de l'église. Une maison devait servir de classe. Il en fit déplacer 2 autres qu'il relia ensembles. À l'ouverture du couvent, en 1885, il y avait 132 filles dont une douzaine qui venaient de toutes les régions de la côte. Le premier hiver fut très dur. Les 8 poêles installés dans le couvent parvenaient difficilement à réchauffer la place.
Pointe aux esquimaux, c'était le nom de Havre-Saint-Pierre, à l'arrivée des premières familles des Iles de la Madeleine. Les malheurs les plus divers, y compris des mortalités s'abatirent sur les lieux. On assista à un va-et-vient de communautés religieuses se succédant.
A cette époque, Havre-Saint-Pierre était la municipalité la plus importante de la Côte-Nord. C'est là que se trouvait l'évêcher de la Côte-Nord. Plusieurs pièces importantes de notre riche patrimoine national ont disparu avec les valeurs qui les avaient fait naître. Sur la photo qui suit, vous pouvez voir l'église de Havre St-Pierre, l'évêcher, en face de l'église et le couvent près du lieu où se trouve l'hopital actuel face à la mer. Tous ces édifices dont la valeur patrimoniale était inestimable sont aujourd'hui disparus. Pourquoi? Comment? Mes prochains billets vous dévoileront une partie du mystère. Et on peut certainement se demander si, au nom du progrès, on ne fait pas trop table rase de tout ce qui a existé de béton, de bois, de valeurs, de monuments historiques, de communautés humaines, de cours d'eau, réserves minières...